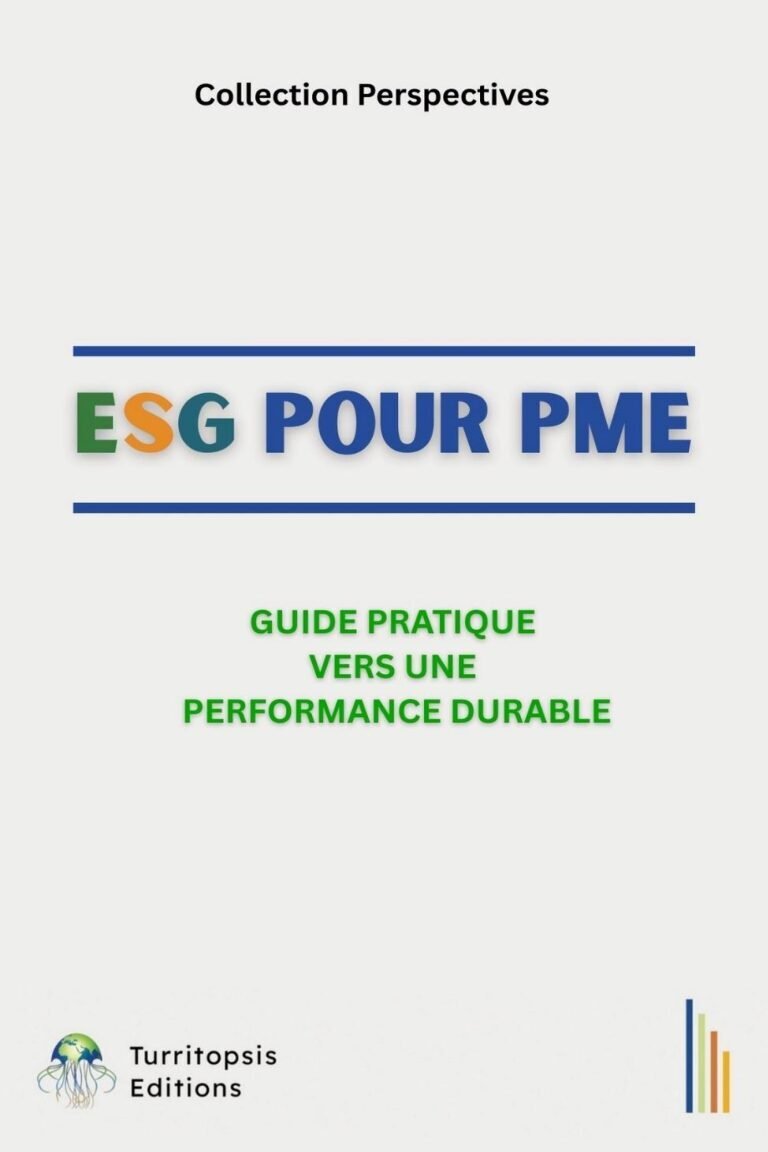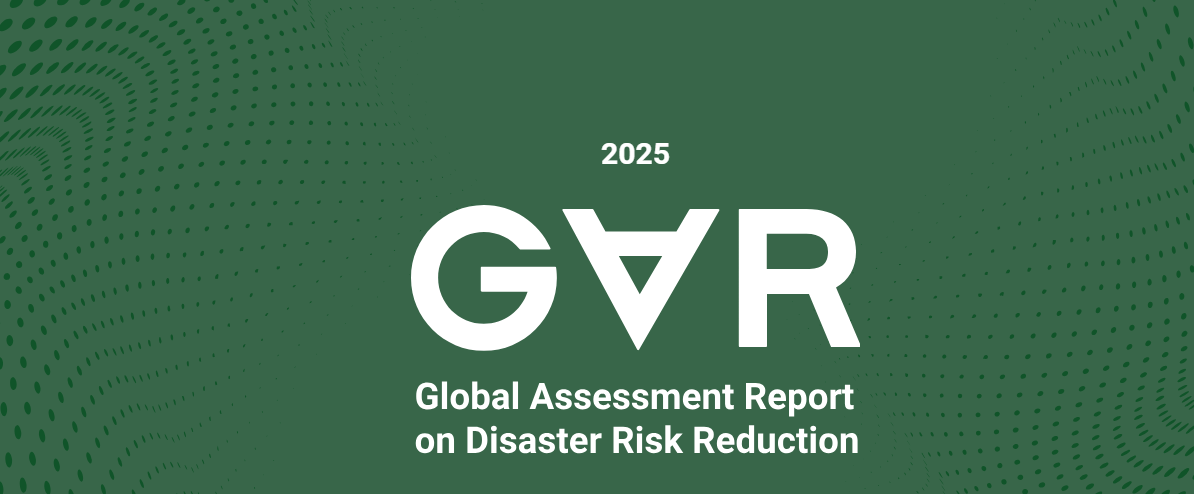Janvier 2026 — Davos 2026 : un forum essentiel à l’heure de ruptures multiples
Janvier 2026
La 56ᵉ réunion annuelle du Forum économique mondial (World Economic Forum, WEF) s’est tenue à Davos-Klosters, en Suisse, du 19 au 23 janvier 2026, sous le thème « A Spirit of Dialogue » — une invitation assumée au dialogue dans un monde fracturé. Réunissant près de 3 000 décideurs politiques, chefs d’entreprise, acteurs de la société civile et universitaires — dont plus de 60 chefs d’État —, Davos 2026 s’est déroulé dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques croissantes, la transformation technologique et des défis économiques persistants.
L’édition 2026 n’a pas seulement cherché à diagnostiquer l’état du monde ; elle a mis en lumière les interactions complexes entre pouvoir, technologie, coopération et croissance. Plutôt que de produire un plan unique, les débats ont révélé des ruptures systémiques profondes, tout en soulignant la nécessité stratégique du dialogue multilatéral face à des incertitudes inédites.
1. Un monde en tension : géopolitique, ordre international et coopération
Davos 2026 aura été dominé par une question centrale : le monde est-il en train de basculer vers un nouvel ordre international ?
Des dirigeants comme Mark Carney, Premier ministre du Canada, ont qualifié la situation actuelle de « rupture dans l’ordre mondial », soulignant que les modèles traditionnels de coopération multilatérale sont remis en question par des politiques unilatérales et des rivalités accrues entre grandes puissances.
Plusieurs interventions ont mis en exergue la fragilisation de l’ordre fondé sur des règles : tensions commerciales, réactions aux démarches territoriales contestées et divergences croissantes entre les approches américaine, européenne et asiatique. Les débats ont montré que la solidarité entre alliés n’est plus donnée, mais doit être réaffirmée activement.
Malgré ces fractures, Davos a confirmé l’importance du dialogue institutionnel et diplomatique comme voie vers la coopération, même lorsque les consensus sont de plus en plus difficiles à atteindre.
2. L’intelligence artificielle sur tous les fronts : opportunités et risques
L’un des fils rouges de Davos 2026 a été l’impact transformateur de l’intelligence artificielle (IA). Alors que l’IA promet une accélération des gains de productivité et d’innovation, elle soulève aussi des questions économiques et sociales profondes.
La directrice générale du FMI a qualifié l’IA de « tsunami » sur le marché du travail, affectant jusqu’à 60 % des emplois dans les économies avancées et 40 % au niveau mondial — avec des implications majeures pour les jeunes entrants sur le marché et la classe moyenne.
Parallèlement, des dirigeants d’entreprises et experts — dont Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase — ont averti contre une adoption trop rapide de l’IA, qui pourrait provoquer des pertes d’emplois massives si des mesures d’accompagnement social et de requalification ne sont pas mises en place.
L’IA est apparue ainsi non seulement comme un facteur de croissance mais aussi comme un défi sociopolitique majeur, nécessitant des cadres de gouvernance robustes, des stratégies de développement des compétences et une coopération entre secteurs publics et privés.
3. Résilience économique et enjeux de croissance
Sur le plan macroéconomique, plusieurs intervenants ont souligné la résilience relative de l’économie mondiale malgré l’instabilité politique et les perturbations récentes. Des représentants de la BCE, du FMI et de l’OMC ont noté que la croissance mondiale reste soutenue, bien que insuffisante pour résoudre des défis structurels tels que la dette, les inégalités et la productivité stagnante.
Les discussions à Davos ont également porté sur la nécessité de stimuler l’innovation, renforcer l’investissement dans les infrastructures humaines et physiques, et assurer une croissance inclusive et durable à long terme.
Sur les marchés financiers, certaines banques, dont JPMorgan, ont observé une dynamique robuste des flux d’investissement et du capital-risque, y compris l’intérêt soutenu pour les zones comme l’Inde et l’Asie-Pacifique.
4. Vers plus de questions que de réponses : l’esprit du dialogue renouvelé
Un enseignement marquant de Davos 2026 est que le forum ne s’est pas contenté de fournir des solutions toutes faites, mais a mis l’accent sur l’articulation des questions essentielles que le monde doit affronter : comment concilier croissance, technologie, justice sociale et coopération géopolitique ? Comment construire un système économique plus résilient et équitable ?
Cette approche — embrasser l’incertitude et encourager des dialogues ouverts — reflète le thème central de « l’esprit de dialogue », qui a servi de catalyseur pour connecter parties prenantes aux perspectives divergentes. L’événement a montré que les défis globaux actuels ne peuvent être résolus par une seule institution ou une seule stratégie, mais nécessitent des plateformes transversales de coordination.
Conclusion : un Davos en phase avec les « questions de notre temps »
Davos 2026 s’est distingué par son intensité, sa diversité d’acteurs et la profondeur des enjeux abordés. Si certains spectateurs ont critiqué le forum pour son caractère élitiste, cette édition a néanmoins réussi à mettre en lumière les dilemmes géopolitiques, les ruptures économiques et les transformations technologiques qui façonnent l’agenda mondial. Elle rappelle que, dans un monde de plus en plus complexe, les espaces de dialogue et de confrontation d’idées restent indispensables à toute tentative de progrès partagé.
References:
https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/
https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/
https://www.weforum.org/stories/all/
https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/davos-2026-was-not-meeting-mirror-reflecting-broken-world–ecmii-2026-01-27/